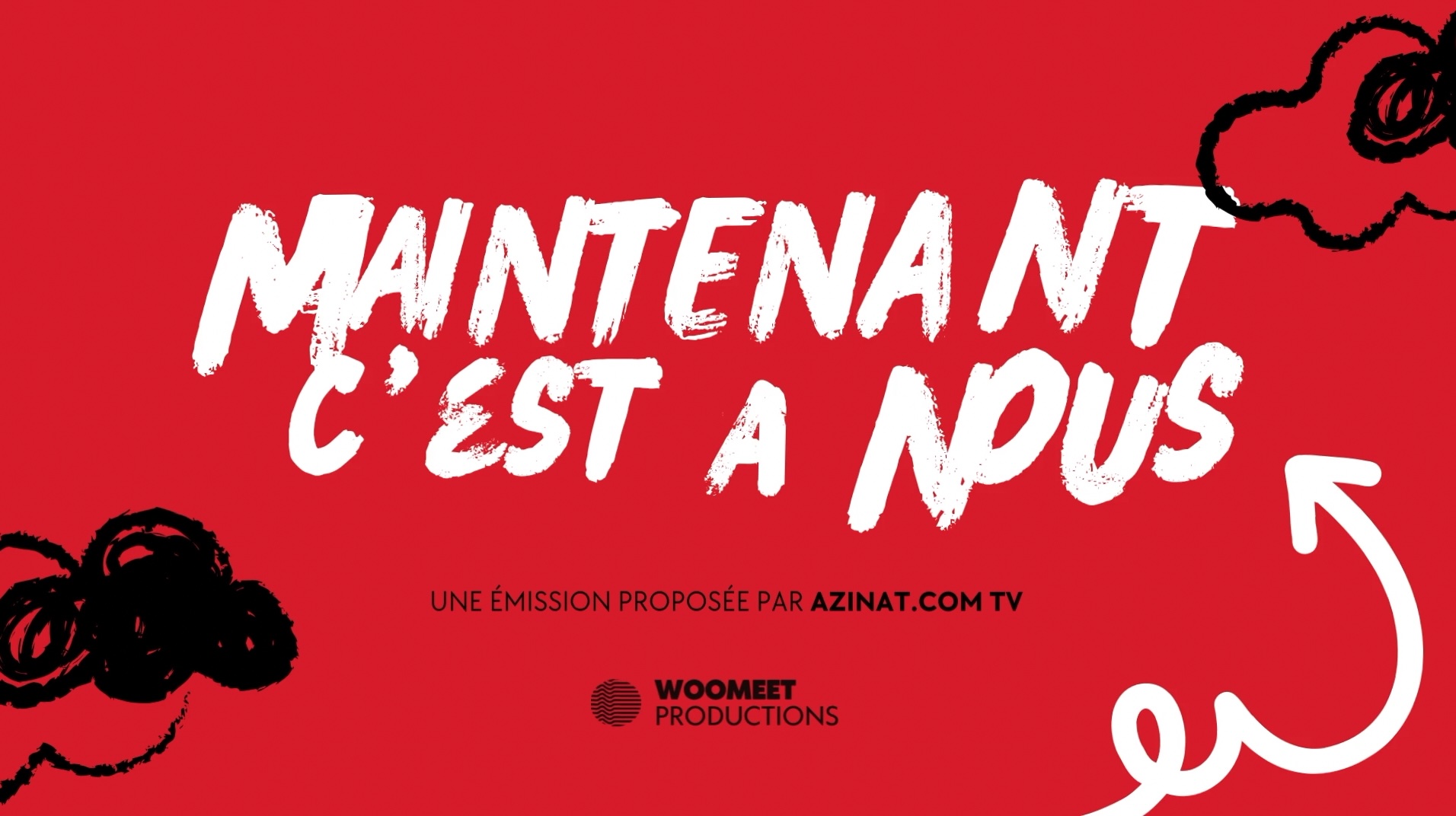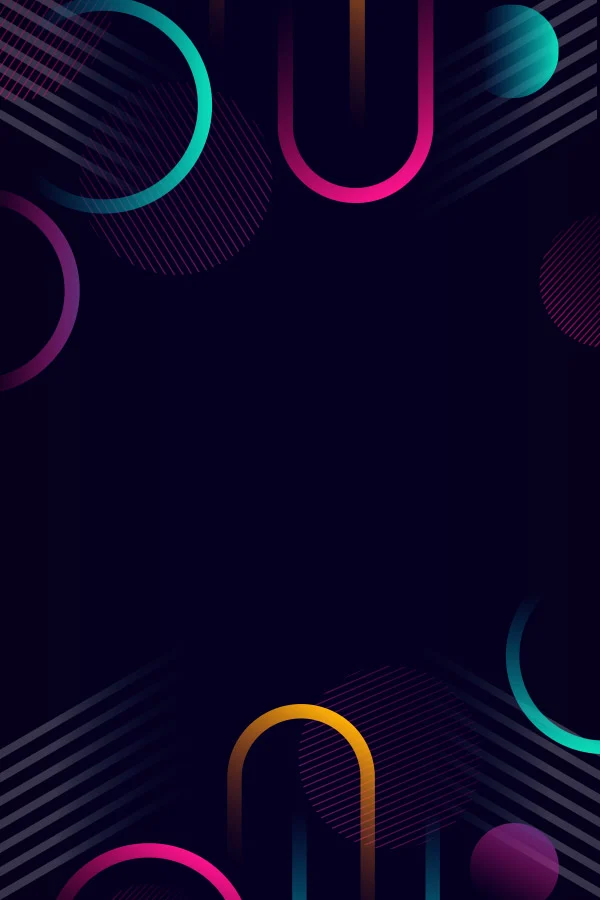REPORTAGE 🎙️Nous sommes aller rencontrer Stephane Amiel et Laurent Triolet à 2246 mètres d’altitude au refuge des Estagnous au pied du Mont Valier que nous avons pu atteindre ensuite par une belle journée ensoleillée. Ils nous présentent le refuge, leur métier de gardien, la vie du refuge loin de leur famille respective pendant les quelques mois d’ouverture…
À 2 246 mètres, au pied du majestueux Mont Valier, le refuge des Estagnous vit au rythme des pas des randonneurs. Depuis plusieurs années, Stéphane Amiel et Laurent Triolet en sont les gardiens. Un métier discret mais essentiel, fait d’endurance, de convivialité et d’amour de la montagne.
Au refuge des Estagnous, la montagne au quotidien
Au refuge des Estagnous, la journée commence bien avant le lever du soleil. « Ça démarre par le petit-déjeuner, donc on se lève tôt pour chauffer l’eau, préparer, mettre en place. Ensuite, quand les randonneurs partent, nous, on enchaîne avec le ménage du bâtiment, qui est quand même assez grand », raconte Stéphane Amiel avec un sourire fatigué mais enthousiaste.
Car derrière l’image de carte postale du refuge de montagne, il y a une organisation réglée comme du papier à musique. Le midi, omelettes et sandwiches pour les marcheurs de passage. Puis dès l’après-midi, il faut préparer le dîner pour les dizaines de convives attendus à 19 heures. « La journée se termine toujours tard, après avoir tout nettoyé et rangé. Et il y a encore les factures, souvent faites le matin ou le soir », ajoute Laurent Triolet.
La logistique, un défi permanent
Rien ne se fait sans une organisation de fourmi. Isolé, accessible uniquement à pied après 1 300 mètres de dénivelé et quatre heures de marche, le refuge dépend en grande partie de l’hélicoptère. « En gros, c’est quatre ou cinq jours de boulot de mise en place pour l’héliportage. Ensuite, l’hélico monte la marchandise par « Bag » de 700 à 800 kilos », explique Stephane.
Une fois les cargaisons déposées, il faut tout ranger et gérer les stocks avec une précision chirurgicale. « C’est primordial, parce qu’ici, la moindre erreur coûte cher. On complète avec des producteurs locaux : fromages, bières, pain de la vallée voisine. Mais ça veut dire des tournées entières en fourgon et remorque en bas, puis tout remonter », précise Stéphane.
Plus de 3 000 nuitées par saison
Le refuge n’a rien d’un havre solitaire. Chaque année, il accueille plus de 3 000 personnes. « Malgré l’accès difficile, il y a du monde. Le Mont Valier a un énorme pouvoir d’attraction », expliquent-ils. Le circuit transfrontalier du Pass’Aran attire à lui seul près de 800 randonneurs chaque année, dont de nombreux Espagnols. À cela s’ajoute une clientèle de passage : campeurs venus planter leur tente, marcheurs pour un simple repas, familles en quête d’aventure estivale.
Mais les conditions montagnardes restent implacables : orages, froid, neige tardive. Les gardiens doivent jongler avec une capacité d’accueil limitée à 74 places assises à l’intérieur. « Par beau temps, on installe sur la terrasse. Mais s’il fait mauvais, il faut passer en deux services. Et après, on finit forcément plus tard », explique Stéphane.
L’accueil, première mission
Au-delà des repas et des couchages, le rôle de gardien est profondément humain. « La plus grosse qualité, c’est l’empathie. Les gens viennent chercher de l’accueil, de l’écoute, et il faut aimer ça. Et puis il y a l’amour de la montagne, qui nous pousse à accepter des conditions parfois rudes », dit Stéphane.
La propreté du refuge, la qualité des repas, les conseils sur les itinéraires ou la météo sont autant de marques d’attention. « On est aussi les premiers maillons de la chaîne de secours. Ici, le téléphone ne passe pas toujours, alors en cas de pépin, les gens viennent frapper chez nous », souligne Laurent.
Les gardiens se transforment ainsi en guides improvisés, relais de sécurité, voire pédagogues auprès des visiteurs curieux de tout savoir sur la faune, la flore ou la géologie des Pyrénées.
Entre ours, isards et randonneurs
Le refuge se situe en zone de présence de l’ours. « Oui, il circule dans le secteur, on a déjà vu des traces dans la neige au printemps », raconte Stéphane. Mais pas de panique : aucune tente n’a encore été visitée. En revanche, l’ours implique une autre cohabitation : celle avec les chiens de protection des troupeaux, qui peuvent impressionner les randonneurs. « Là encore, il faut beaucoup de pédagogie », note Stephane.
Les gardiens constatent aussi l’évolution de la fréquentation. Depuis le Covid, de plus en plus de campeurs viennent s’installer autour du refuge, profitant des sanitaires et de l’eau disponible.
Une saison courte mais intense
La saison d’ouverture dépend directement de l’enneigement. « On démarre mi-juin, plus tard que d’autres refuges, parce que le Vallier reste longtemps enneigé. Et on ferme début octobre, avant les risques de gel qui bloquent l’eau », explique Stéphane.
Quatre mois à 100 à l’heure, puis l’hiver en famille… du moins en apparence. Car le métier ne s’arrête pas à la fermeture des portes. « Si on compte la logistique, les réunions, les précommandes, l’association des gardiens, le Pass’Aran, ça fait en réalité six mois de travail à temps complet », précise Stéphane.
Entre passion et endurance
Tous deux ont un parcours ancré dans la montagne. Ancien accompagnateur en montagne, Stéphane a longtemps mené une double activité. Laurent, lui, vient du monde du ski et des saisons d’hiver. Tous deux reconnaissent que le métier demande une endurance rare. « C’est six jours sur sept, voire sept, et le jour de repos, on fait souvent… les mails du refuge », sourit Stéphane.
Et pourtant, aucun ne donnerait sa place. « Ce qui nous anime, c’est l’accueil, la rencontre, le partage. Et la montagne, bien sûr. Malgré les contraintes, c’est une vie passionnante », concluent les deux gardiens.
Nota : images de drone réalisées par Azinat.com TV aux abords du refuge avec dérogation de la préfecture de l’Ariège. On rappelle que le survol en drone n’est pas autorisé (sauf de dérogation) au dessus de 1000 mètres par arrêté préfectoral de juin 2025 pour éviter les nuisances auprès de la faune sauvage, notamment sur des sites protégés.